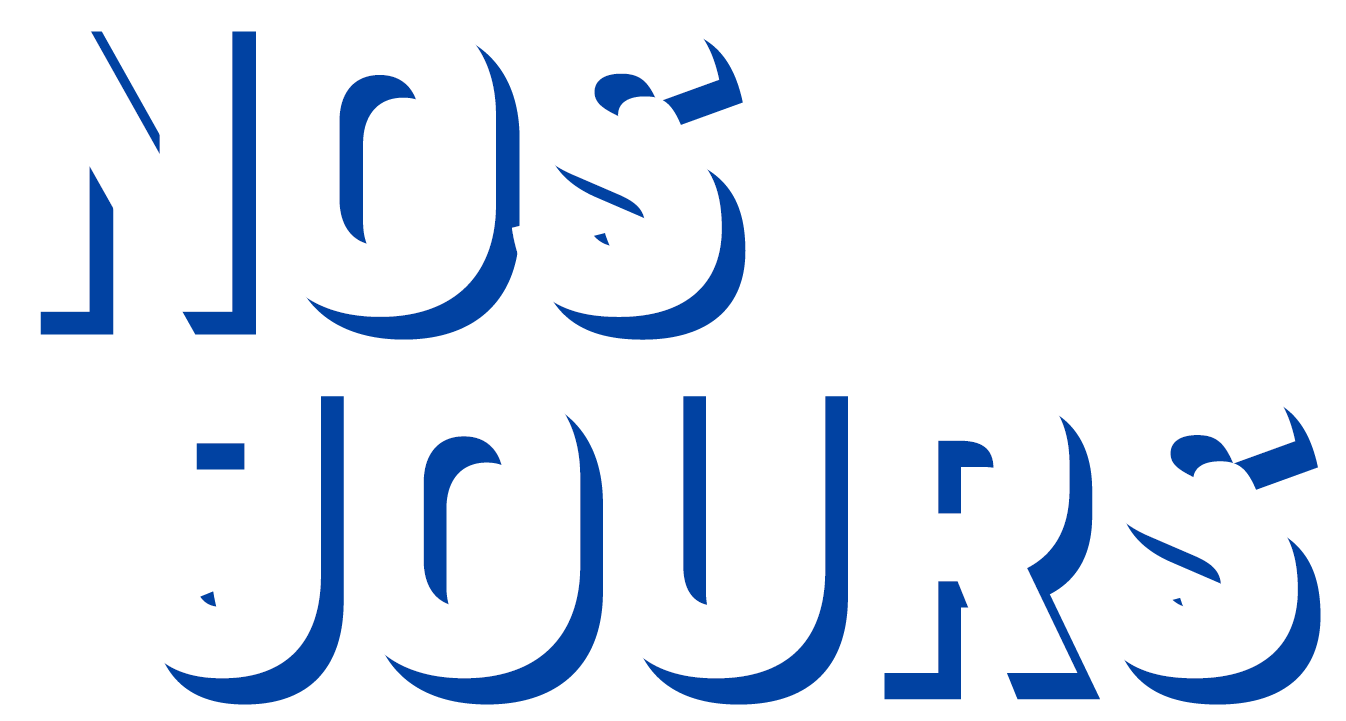Cent jours après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a réinstauré une présidence offensive, unilatérale et imprévisible. Mais sa popularité s’érode déjà, plombée par les tensions diplomatiques et les inquiétudes économiques.
« L’Amérique d’abord » devient « L’Amérique contre tous »
Sitôt installé, Trump a rouvert plusieurs fronts commerciaux. Il a imposé des droits de douane de 60 % sur les importations chinoises de technologies avancées, déclenchant des mesures de rétorsion immédiates de Pékin. L’Union européenne, à son tour, a vu réapparaître des barrières sur l’acier, l’aluminium et même certains produits agricoles français, officiellement pour protéger la « sécurité nationale » des États-Unis. Le Japon et la Corée du Sud ne sont pas épargnés.
À Davos, en février, la délégation américaine a été accueillie froidement. Plusieurs partenaires ont annoncé leur intention de porter plainte auprès de l’OMC. La directrice générale de l’Organisation a parlé d’« une crise de légitimité commerciale sans précédent depuis les années 30 ». Washington assume. « Nous ne laisserons plus personne profiter de notre marché sans contrepartie », a déclaré Trump.
Le Canada, prochain État américain pour Donald Trump ?
Le ton a franchi un nouveau seuil avec le Canada. Depuis janvier, Trump multiplie les attaques contre le gouvernement canadien, accusé de « dumping énergétique » et de « complicité avec la Chine ». Le président américain a déclaré vouloir négocier « une réintégration structurelle » du Canada dans le cadre fédéral américain, propos qualifiés d’« absurdes et hostiles » par Ottawa.
Plusieurs figures trumpistes plaident désormais pour un « rattachement stratégique » du Canada, motivé par la sécurité énergétique et la lutte contre l’immigration illégale. Le Congrès n’a pas suivi, mais l’exécutif a gelé plusieurs coopérations bilatérales, suspendu les visas de travail canadiens et annoncé la taxation des importations d’électricité québécoise. Cette radicalisation inquiète jusque dans les rangs républicains modérés.
L’immigration, une priorité martelée
Dans ce contexte, la politique migratoire constitue l’un des rares marqueurs d’unité chez les partisans de Trump. Le président a signé un décret abolissant les protections temporaires pour plus de 600 000 ressortissants originaires du Salvador, du Venezuela et du Soudan. Les expulsions ont bondi de 46 % en trois mois, selon les chiffres de l’agence ICE. Un nouveau programme de rétention des demandeurs d’asile a été déployé dans quatre États frontaliers, sans intervention du Congrès.
Le mur à la frontière mexicaine, chantier emblématique de son premier mandat, a repris, financé en partie par des coupes dans l’aide internationale. Trump a promis « 500 kilomètres supplémentaires d’ici décembre ». L’opération séduit sa base, mais soulève l’opposition des autorités locales et de la justice fédérale dans plusieurs États.
L’économie prend l’eau
Sur le plan économique, les indicateurs boursiers restent orientés à la hausse – le Dow Jones a progressé de 8 % depuis janvier – mais les tensions commerciales fragilisent les entreprises exportatrices. Plusieurs grands groupes industriels américains, comme Caterpillar ou Boeing, ont revu leurs prévisions à la baisse. Le chômage reste faible (3,6 %), mais l’inflation a dépassé les 5 % en rythme annuel, poussée par la hausse des droits de douane et de l’énergie.
Trump a proposé une nouvelle baisse d’impôts pour les entreprises et annoncé un plan de relance de 1 000 milliards de dollars pour les infrastructures, dont le financement reste incertain. Les agences de notation ont exprimé leur scepticisme, évoquant un « risque de dérapage budgétaire majeur ».
Une diplomatie à l’épreuve de la méthode Trump
En politique étrangère, le président a renouvelé sa promesse de « ne plus faire la guerre pour les autres ». Les livraisons d’armes à l’Ukraine se poursuivent, mais sous conditions strictes. Trump a demandé que les pays européens « paient leur part », y compris pour l’aide humanitaire. L’OTAN, selon ses mots, doit devenir « un club d’égaux, pas un protectorat ».
Avec la Russie, les relations sont ambiguës. Trump a invité Vladimir Poutine à une conférence sur la sécurité énergétique, prévue à Houston en juin. Mais dans le même temps, il a approuvé de nouvelles sanctions contre des oligarques russes. En Iran, la tension reste vive : en mars, un drone américain a tué un commandant des Gardiens de la Révolution dans le sud de l’Irak.
Un président qui divise, même son camp
Selon le dernier sondage Gallup, seuls 39 % des Américains approuvent l’action de Donald Trump, un score historiquement bas pour un début de mandat. Signe de tensions internes, plusieurs sénateurs républicains refusent désormais de s’exprimer sur les décisions du président. Le caucus évangélique reste fidèle, tout comme les électeurs ruraux du Midwest, mais dans les banlieues et les États clés, l’inquiétude gagne.
À cent jours du pouvoir, Trump gouverne comme il a fait campagne : seul contre tous, sûr de sa légitimité, indifférent aux conventions. La suite dépendra autant de la solidité de ses soutiens que de sa capacité à éviter l’isolement international et les secousses économiques.