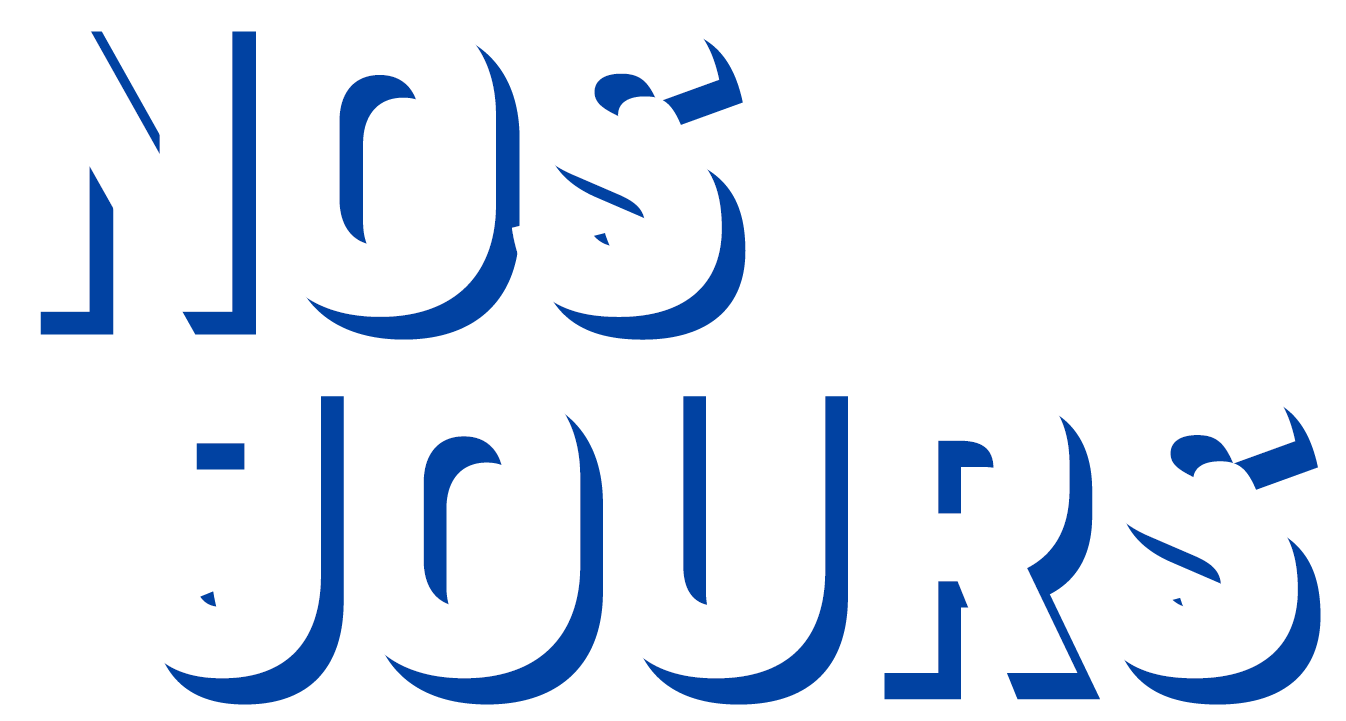Alger monte à nouveau d’un cran. Un mois après l’expulsion de 12 fonctionnaires français, les autorités algériennes ont demandé le rapatriement immédiat de 15 agents supplémentaires. Paris dénonce une « décision brutale » et promet une réponse immédiate, ferme et proportionnée. Un épisode de plus dans cette série de tensions qui fragilisent une relation entre les deux états, déjà plus que glaciale.
Une escalade préoccupante
Dimanche 11 mai, le ministère algérien des Affaires Étrangères a convoqué le chargé d’affaires français à Alger, Gilles Bourbao. L’Algérie accuse officiellement la France de « manquements flagrants aux accords consulaires » , notamment l’utilisation de passeports diplomatiques pour des agents relevant du ministère de l’Intérieur, envoyés sans notification préalable.
Cette mesure s’ajoute à celle du 14 avril dernier, lorsqu’Alger avait exigé le départ de 12 fonctionnaires français. Ces expulsions font suite à l’arrestation en France de trois ressortissants algériens. Ces derniers sont suspectés d’avoir tenté d’enlever l’influenceur Amir DZ, exilé en France et critique du régime algérien.
Une réponse française imminente
À Paris, l’étonnement égale l’indignation. Selon le Ministère des Affaires Étrangères : « ce chiffre de 15 agents ne correspond à rien ». Certains de ces agents seraient des renforts pour des missions courtes. Et envoyés dans le cadre de l’accord bilatéral de 2013 sur la mobilité diplomatique. Face à cette annonce, Le Quai d’Orsay a promis une « riposte immédiate ».
C’est un geste incompréhensible qui va à l’encontre de nos intérêts communs.
– Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères
Une relation historiquement instable
Cette nouvelle crise illustre les fragilités structurelles et historique des relations franco-algériennes. Depuis son indépendance en 62, les rapports en l’Algérie et la France ont toujours été marqués par la méfiance. L’ancien ambassadeur Xavier Driencourt parle d’un « double aveuglement entre une Algérie gouvernée par un système militaire opaque, et une France entravée par sa culpabilité post-coloniale ».
Les tensions sont également alimentées par les rapprochements entre la France et le Maroc. En octobre dernier, Emmanuel Macron a ainsi affirmé que « l’avenir du Sahara occidental s’inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine ». La France, en renforçant ses liens avec le Maroc, alimente ainsi un sentiment de défiance croissante de la part d’Alger. Qui interprète cette posture diplomatique comme une prise de parti contre l’Algérie.
Des affaires politiques récentes
Parallèlement, le cas de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal s’ajoute à ces tensions diplomatiques. Arrêté à l’aéroport d’Alger en novembre 2024. Il a été condamné à cinq ans de prison en mars 2025 pour « atteinte à l’intégrité du territoire national ». Après des propos jugés critiques, par le gouvernement algérien, sur sa politique au Sahara occidental. Âgé de 80 ans et gravement malade, Sansal est détenu dans des conditions dénoncées comme arbitraires et illégales par plusieurs ONG, par le Parlement Européen, et par la France, qui demandent sa libération immédiate.
En France, seule La France Insoumise s’est distingué par son opposition à la libération de Boualem Sansal. Lors du vote d’une résolution à l’Assemblée Nationale appelant à sa libération immédiate, 28 députés LFI ont voté contre le texte. Parmis eux, les députés Mathilde Panot, Manuel Bompard, Gabriel Amard et Idir Boumertit. Ils dénoncent ce qui serait selon eux, une « instrumentalisation politicienne » de l’affaire par la droite et l’extrême droite. Cette position a suscité de vives critiques y compris au sein de la gauche. Certains accusant LFI de faire le jeu du régime algérien en refusant de soutenir un écrivain emprisonné par un régime autoritaire pour ses opinions.
Récemment, une enquête du Journal du Dimanche a révélé que le pouvoir algérien entretiendrait des réseaux d’influence actifs en France. L’article en question, jugé provocateur par Alger, aurait précipité cette nouvelle vague d’expulsions.
Des liens économiques presque inchangés
Malgré les tensions politiques, les échanges économiques entre la France et l’Algérie restent importants. En 2024, ils ont atteint 11,1 milliards d’euros, dont 6,3 milliards d’importations françaises en provenance d’Algérie. La France achète principalement des hydrocarbures (pétrole et gaz), qui représentent près de 80 % des exportations algériennes vers l’Hexagone.
De son côté la France a exporté pour 4,8 milliards d’euros de biens vers l’Algérie, faisant de ce pays son deuxième client en Afrique. Environ 400 entreprises françaises sont présentes sur le sol algérien, et 6 000 y entretiennent des relations commerciales. Ainsi, plusieurs patrons français s’inquiètent d’une détérioration durable, notamment dans l’agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique.
L’Algérie bénéficie également depuis plusieurs années, de la part de la France, d’une aide annuelle au développement oscillant entre 110 et 150 millions d’euros (et non 800 millions comme a pu le soutenir à plusieurs reprises la députée Reconquête! Sarah Knafo). Cette aide intervient principalement dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’environnement.
L’accord de 1968 de nouveau en question ?
La crise actuelle relance le débat sur l’accord franco-algérien de 1968, qui confère des droits particuliers aux ressortissants algériens en matière de séjour et de libbre-circulation en France. De plus en plus de voix s’élèvent du côté français – pour beaucoup issues de mouvement allant de la majorité présidentielle à d’extrême-droite – afin de demander une révision ou une dénonciation unilatérale de cet accord jugé déséquilibré.
À LIRE AUSSI : Crise diplomatique : Paris expulse à son tour 12 diplomates algériens et rappelle son ambassadeur
Faut-il redéfinir la relation franco-algérienne ?
Alors que l’Élysée cherche à préserver un « partenariat d’exception avec l’Algérie », les tensions aussi bien récentes que récurrentes démontrent que les termes de la relation franco-algérienne doit être redéfinies. Pour de nombreux observateurs, la France doit rompre avec son approche ambivalente à l’égard d’Alger, afin de le traiter davantage comme un partenaire stratégique.
À l’heure où l’Algérie représente un acteur énergétique clef pour l’Europe, et un pays autant pivot que stratégique en Afrique du Nord, un dialogue apaisé entre Paris et Alger serait dans l’intérêt des deux nations. Mais à court terme, l’heure est plutôt à la crispation.