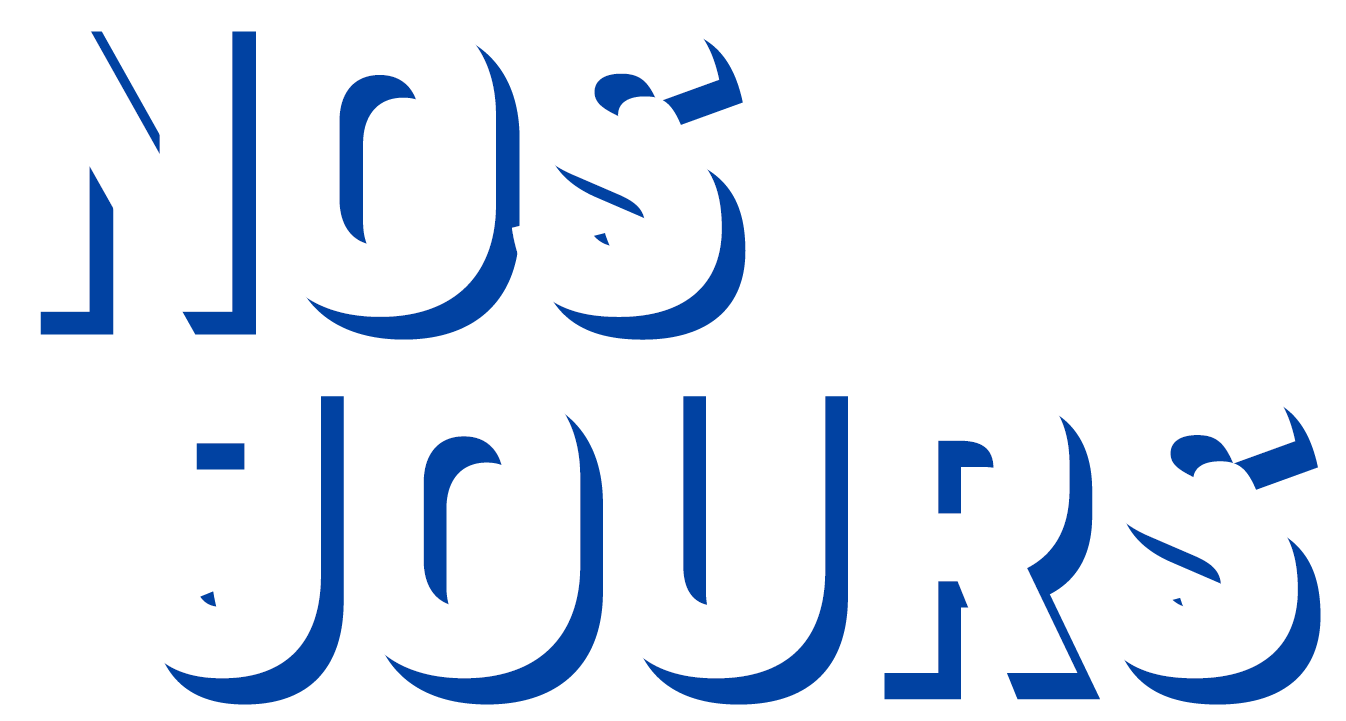Le Président de la République a choisi Douai pour marquer un temps fort de son second mandat. Ce mardi 3 juin, Emmanuel Macron s’est rendu dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais pour inaugurer la nouvelle usine de batteries électriques d’AESC Envision. Une visite hautement symbolique, dans une région autrefois sinistrée par la désindustrialisation, et devenue l’épicentre du renouveau promis par l’exécutif.
Un pari de souveraineté industrielle
« Personne n’y croyait », a lancé le chef de l’État devant les salariés du site. Il y a encore quatre ans, l’endroit n’était qu’un terrain vague à la lisière de l’usine Renault de Douai. Aujourd’hui, le site d’AESC, géant sino-japonais de la batterie, livre ses premières cellules pour équiper les Renault 5 électriques. Une montée en cadence rapide : 2 000 unités déjà produites, avec un objectif de 200 000 véhicules par an à horizon 2026.
À LIRE AUSSI : « C’est un mauvais signal » : Éric Lombard critique l’investissement de 20 milliards de Sanofi aux États-Unis
L’investissement, chiffré à 1,3 milliard d’euros, incarne la volonté de « réindustrialisation décarbonée » prônée par Emmanuel Macron. Et, au-delà, un enjeu de souveraineté industrielle : reprendre la main sur une filière stratégique dominée jusqu’ici par la Chine et la Corée. Aux côtés de Verkor à Dunkerque et d’ACC à Douvrin, AESC est l’un des piliers de la « Vallée de la batterie » française en construction.
Un succès local, des doutes globaux
Cette réussite industrielle, saluée pour sa ponctualité et sa capacité à créer 950 emplois directs d’ici la fin de l’année, intervient pourtant dans un contexte incertain. Depuis le début de l’année, le marché français de la voiture électrique traverse une zone de turbulence. Recul des ventes de 7 %, effondrement de 58 % des immatriculations chez les particuliers au mois de mai, stagnation de la part de marché autour de 18 %. L’abrogation des ZFE, la baisse des bonus et l’instabilité réglementaire nourrissent l’attentisme des acheteurs.
La montée en puissance de l’usine de Douai ne saurait masquer l’essoufflement du secteur. Même les locomotives peinent : Tesla accuse une chute de 67 % de ses ventes en France sur un an. Renault, malgré les succès initiaux de sa R5 E-Tech, voit son modèle menacé par la concurrence de Citroën et ses modèles low-cost comme la ë-C3.
L’Europe à la traîne ?
Face à ces vents contraires, les industriels réclament des aides ciblées. Les patrons des gigafactories françaises – Envision, Verkor, ACC – alertent sur la fragilité du modèle économique. « Il faut des subventions à la production », plaident-ils, citant le cas de Northvolt en Suède, en proie à des difficultés. Un plan d’urgence européen a bien été annoncé au printemps par Bruxelles, promettant 1,8 milliard d’euros. Mais les industriels déplorent un flou persistant et redoutent un effet d’annonce sans mesures concrètes avant l’automne. À Paris, le ministère de l’Industrie s’inquiète : « Nous ne voyons pas la couleur du plan auto », confiait-on fin mai.
Pour Emmanuel Macron, qui mise sur l’industrie pour redonner du souffle à une fin de quinquennat sans majorité, la réussite d’AESC à Douai est un cas d’école. Elle illustre à la fois l’attractivité retrouvée de la France – le projet avait été signé à Choose France en 2021 – et les limites d’une stratégie sans soutien européen robuste.
Une vitrine pour un bilan
Derrière la visite présidentielle, se joue aussi une bataille de perception. À deux ans de la fin de son mandat, Macron défend son bilan dans les Hauts-de-France, région emblématique de la fracture territoriale. L’« Engagement pour le renouveau du bassin minier », signé en 2017, a permis la rénovation de 15 500 logements et la création de 2 200 emplois industriels entre 2022 et 2024. Mais le taux de pauvreté reste de 21 %, bien au-dessus de la moyenne nationale.
En choisissant Douai, le président veut montrer que l’écologie peut rimer avec économie, que la politique industrielle française n’est pas qu’une stratégie de plans PowerPoint. Encore faut-il que les électrons circulent jusqu’au marché. Et que les batteries, aussi performantes soient-elles, trouvent des voitures à alimenter.