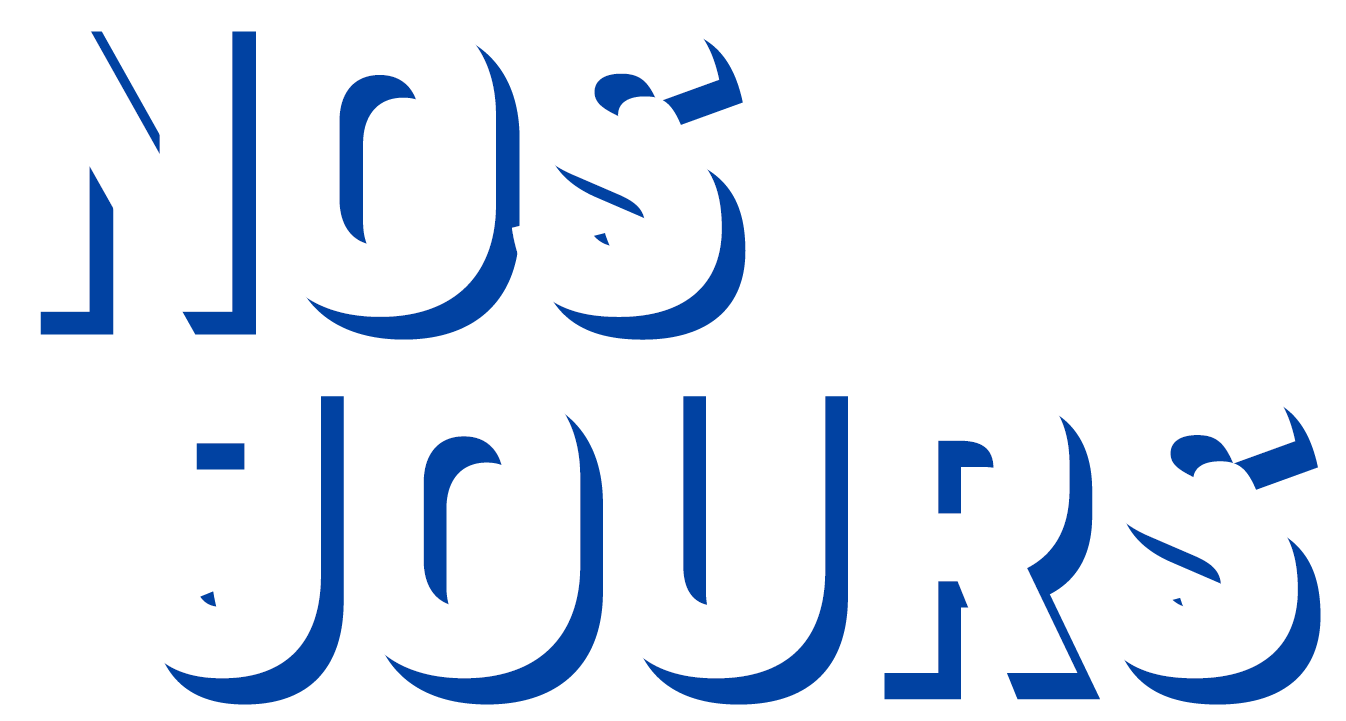« Parler, c’est exister », martèle Fanny. En 2018, son père a tué sa mère de plusieurs coups de couteau le lendemain de Noël. À 20 ans, elle perd ses deux parents d’un coup : l’un est mort, l’autre emprisonné. Et sa petite sœur, placée, lui est arrachée. C’est son histoire — et celles de dizaines d’autres — que raconte le documentaire « (Sur)vivants », diffusé ce mercredi 4 juin à 21h10 sur Canal+.
À LIRE AUSSI : Tarik Saleh : Portrait d’un réalisateur qui ose
Après « Vivante(s) », consacré aux femmes victimes de violences conjugales, la réalisatrice Claire Lajeunie poursuit sa plongée dans les ravages du patriarcat en braquant cette fois la caméra sur les orphelins des féminicides. En France, ils sont chaque année plus d’une centaine à perdre leur mère, assassinée par un conjoint ou un ex-compagnon. Derrière la statistique, il y a des enfants. Et un silence assourdissant.
« De survivants à vivants »
Fanny est la figure centrale du film. Fil rouge et voix forte, elle incarne ces trajectoires cabossées qui peinent à se reconstruire. Elle raconte avoir dû organiser seule les obsèques de sa mère, nettoyer elle-même la scène de crime, faire face à une avalanche de démarches administratives, tout en poursuivant ses études et en demandant — en vain — la garde de sa sœur. « Aucun enfant ne devrait se retrouver seul après avoir tout perdu », confie-t-elle à l’écran.
À ses côtés, d’autres témoignages bouleversants. Cloé, 7 ans au moment du drame, a vu son père brûler vive sa mère. Anne-Sophie a dû récurer le sang sur les murs familiaux. Laurence et Françoise, elles, ont découvert 36 ans après le meurtre de leur mère que l’État leur réclamait de payer l’Ehpad de leur père meurtrier. « Une double peine », résume l’avocate Camille Martini : perdre une mère, puis affronter la violence froide des institutions.
L’angle mort de l’après
C’est tout l’intérêt de ce film que de déplacer le regard. On parle des féminicides, mais très rarement de ce qu’ils laissent derrière eux. Lajeunie, elle, interroge ce que devient un enfant lorsque toute sa structure familiale et affective s’effondre d’un coup. La réponse est accablante : désintérêt des services sociaux, placements en foyers défaillants, fratries séparées, suivi psychologique quasi inexistant.
Jusqu’en 2024, un père incarcéré pour meurtre gardait même l’autorité parentale sur ses enfants. Il pouvait interdire un déménagement, refuser un voyage scolaire. Ce n’est que depuis mars dernier que la loi a suspendu automatiquement cette autorité en cas de crime sur l’autre parent.
Un documentaire militant
Si « (Sur)vivants » émeut, c’est aussi parce qu’il est incarné. Filmé sur un an, avec une grande liberté artistique laissée par Canal+, il adopte un ton sensible, pudique, mais jamais larmoyant. Les enfants s’expriment dans des groupes de parole ou en tête-à-tête, parfois à visage couvert. Peu de garçons témoignent : par honte, par pudeur. « Il y a encore une vraie difficulté à se dire victime quand on est un homme », note la réalisatrice.
Claire Lajeunie assume une démarche militante. Son film est pensé comme un outil : il sera projeté dans des prisons, auprès des forces de l’ordre, dans des centres d’accueil. L’Union nationale des familles de féminicides (UNFF), fondée par la tante de Cloé, milite pour la création d’un statut spécifique pour ces enfants. Un statut de victime, avec des droits, un suivi psychotraumatique gratuit, l’accès à un logement ou à une bourse.