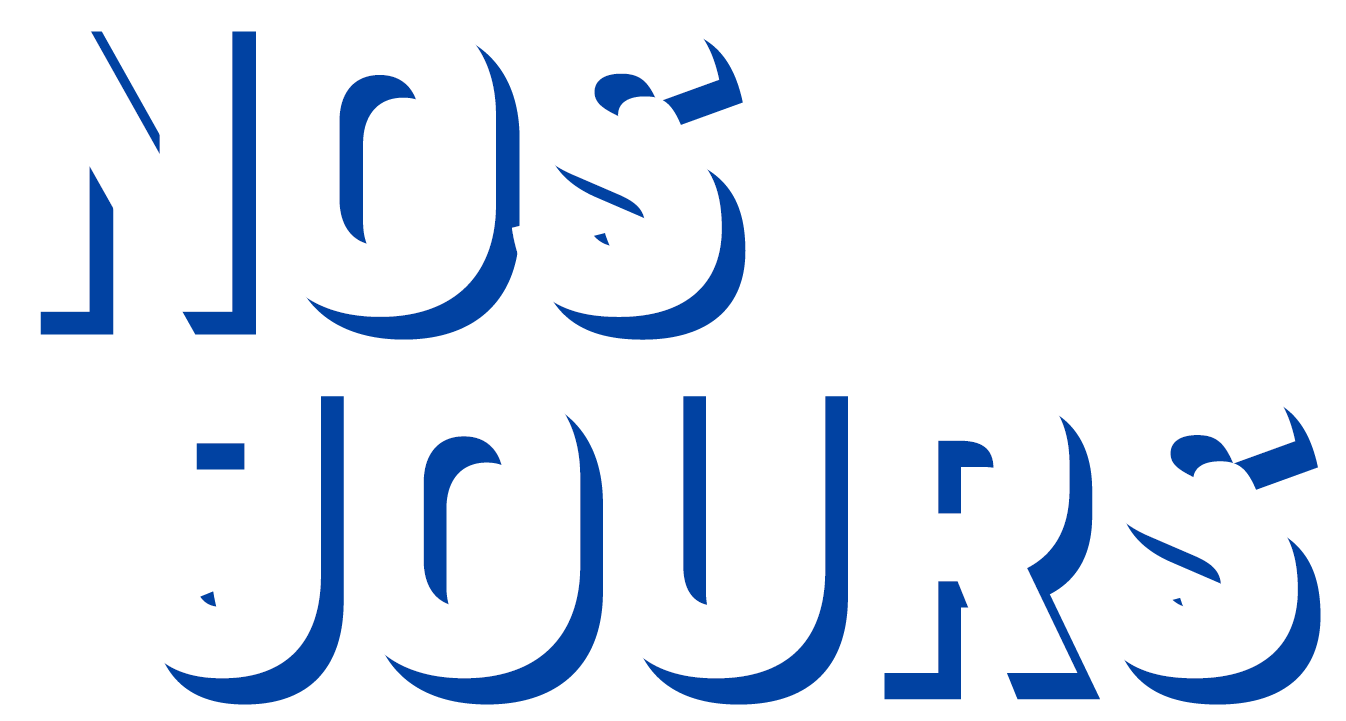Le chiffre tombe à un moment charnière. Alors que les regards se tournent déjà vers les Jeux olympiques d’hiver de 2030, la Cour des comptes vient de publier, ce lundi 23 juin, une note d’étape consacrée à Paris 2024. Elle y dresse un premier état des lieux du financement des Jeux olympiques et paralympiques, avec un constat sans appel : l’effort public s’est élevé à près de 6 milliards d’euros, soit le double de ce qu’avait avancé le gouvernement au début de l’organisation.
« Il s’agit d’un exercice budgétaire hors norme, dont les enseignements doivent impérativement nourrir les événements à venir »
Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes
Une addition bien plus salée que prévu
Dans le détail, l’institution répartit ces 5,96 milliards d’euros en deux grandes masses. D’une part, 2,77 milliards pour les dépenses d’organisation, incluant la sécurité, les transports, la billetterie populaire ou encore les primes des agents mobilisés. D’autre part, 3,19 milliards pour les infrastructures sportives, d’hébergement et de voirie, portées en majorité par les collectivités territoriales.
Ces chiffres contrastent fortement avec ceux mis en avant par le gouvernement durant toute la préparation des Jeux. Encore en mars 2024, le ministre délégué aux Comptes publics, Thomas Cazenave, évoquait un effort public autour de 3 milliards d’euros. Même le Premier ministre, Gabriel Attal, n’anticipait qu’une enveloppe « proche de 5,3 milliards ». « Il y a clairement eu un sous-calibrage des dépenses, notamment sur le volet sécurité. C’est le poste qui a explosé », note un haut fonctionnaire interrogé par Les Échos.
La sécurité, premier poste de dépense
Selon la Cour, la sécurité a englouti à elle seule 1,44 milliard d’euros, soit plus de la moitié des dépenses d’organisation. Une somme largement sous-estimée au départ. Dès 2020, les magistrats alertaient sur l’absence de budgétisation précise de cette composante. En vain.
Policiers, gendarmes, agents Sentinelle, vigiles, cybersécurité, vidéosurveillance : l’ensemble du dispositif a été étoffé au fil des mois, jusqu’à atteindre des sommets. En décembre 2023, à quelques semaines de l’ouverture des Jeux, 900 millions d’euros supplémentaires ont dû être débloqués en urgence, selon Le Monde. Le Sénat évoque, de son côté, 1,14 milliard pour la mobilisation des forces de l’ordre sur l’ensemble de la période olympique.
Les coûts liés à la cybersécurité – 64 millions d’euros –, à la vidéoprotection – 100 millions –, ou encore aux indemnités des fonctionnaires en renfort – 300 millions – se sont aussi ajoutés à la note.
Transports, billetterie, communication : les autres lignes
Les dépenses de transports atteignent 570 millions d’euros, avec une contribution massive de la RATP et de la SNCF pour renforcer l’offre pendant la période des Jeux. Près de 335 millions ont été engagés par ces deux opérateurs publics, selon le rapport.
Autre ligne notable : les efforts consentis pour garantir une mobilisation populaire, avec notamment la billetterie gratuite pour les jeunes, les agents publics et les scolaires, la parade des champions ou encore les campagnes de communication. Coût estimé : 341 millions d’euros.
S’y ajoutent 80 millions d’euros versés par l’Agence nationale du sport pour soutenir les athlètes de haut niveau, ainsi que un peu plus de 700 millions de dépenses de fonctionnement général (logistique, coordination, salaires, locations…).
Les collectivités en première ligne pour les infrastructures
La deuxième moitié de la facture concerne les infrastructures olympiques, dont la gestion a été confiée à la SOLIDEO. Elle englobe la construction du village des athlètes, de plusieurs équipements sportifs (notamment en Seine-Saint-Denis), la réhabilitation d’axes routiers, les aménagements d’accessibilité, et les installations temporaires.
Selon la Cour, 3,19 milliards d’euros ont été mobilisés pour cet ensemble. Une large partie a été financée par les collectivités locales, notamment la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris. Le budget initial de la SOLIDEO – autour de 1,5 milliard – a ainsi plus que doublé en huit ans.
La Cour souligne par ailleurs que d’autres dépenses « indirectes » n’ont pas été intégrées dans ce chiffrage, comme le plan baignade dans la Seine ou certaines opérations de rénovation urbaine.
Paris 2024 défend sa gestion
Le Comité d’organisation des Jeux (COJO) a rapidement réagi, dénonçant un amalgame entre son budget propre et les financements publics globaux. Dans un communiqué publié lundi, Paris 2024 rappelle que son budget de 4,5 milliards d’euros est financé à 96 % par des recettes privées, notamment la billetterie (1,4 milliard), les sponsors (1,2 milliard) et la contribution du CIO (1,2 milliard). La part de l’État y est très faible, à peine 286,9 millions d’euros.
« Il ne faut pas tout mélanger. Le COJO a tenu son budget. Ce que la Cour additionne relève de politiques publiques plus larges, sur lesquelles nous n’avons aucun levier », a réagi Tony Estanguet, président du comité, sur France Inter.
Le gouvernement, lui, minimise l’écart. Gabriel Attal évoque une différence « d’approche méthodologique », en rappelant que certains postes intégrés par la Cour relèvent de choix budgétaires autonomes des ministères, et non de l’organisation stricto sensu des Jeux.
Un signal pour 2030
Alors que la France s’est officiellement vue confier l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030, entre les Alpes et la Provence, la Cour espère que ce bilan servira d’alerte. Elle appelle à mieux encadrer les financements, en anticipant les besoins réels, notamment en matière de sécurité, et en clarifiant les responsabilités.
Un comité interministériel doit d’ailleurs se tenir à Briançon début juillet, avant l’examen du projet de loi sur les Jeux de 2030 au Parlement. Les parlementaires réclament déjà une clause de revoyure et un comité de suivi budgétaire indépendant.