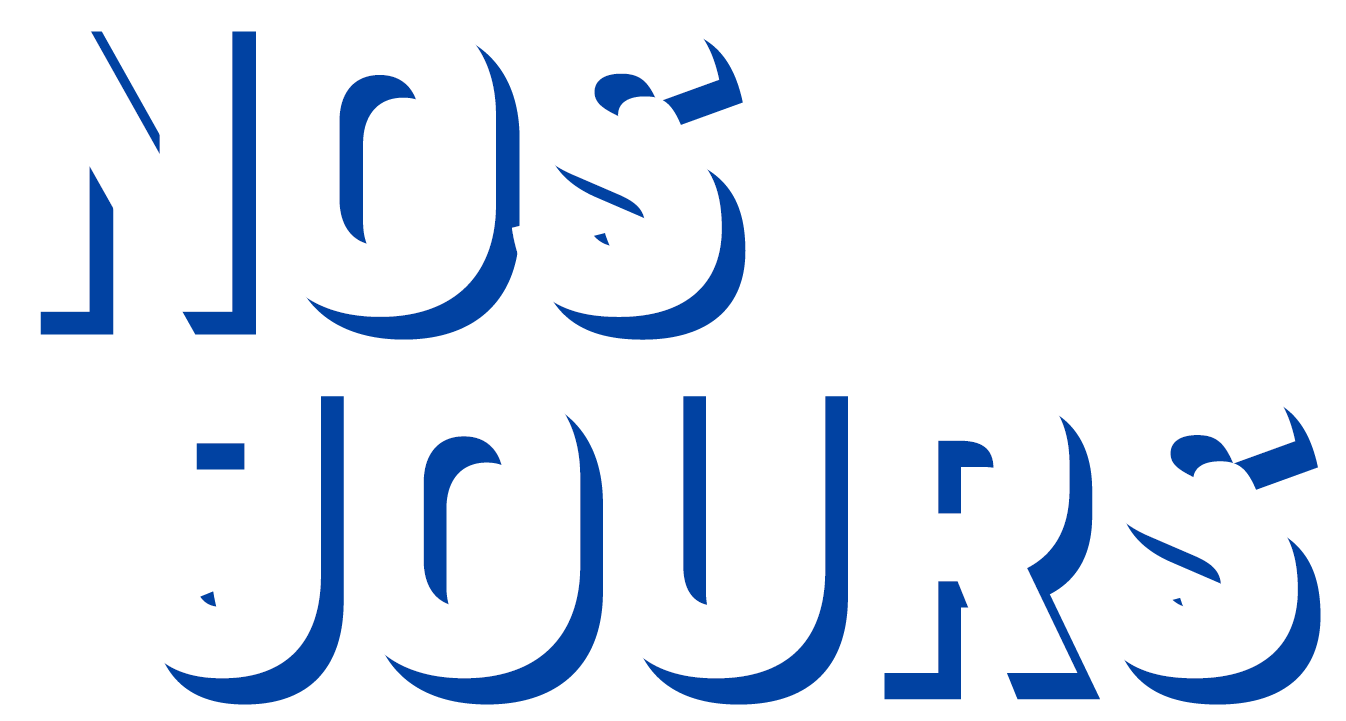Créé en 1999 par Luc Barruet et l’association Solidarité Sida, Solidays a toujours eu une vocation claire : mobiliser les jeunes autour du VIH. Chaque billet finance des programmes d’aide et de prévention en France et à l’étranger. En vingt-cinq ans, plus de 26 millions d’euros ont été redistribués à des associations de terrain.
Mais aujourd’hui, le festival s’est considérablement transformé. Les scènes géantes, les dispositifs marketing des marques partenaires et l’ampleur de la programmation musicale ont modifié le paysage. « Solidays est une main tendue à la jeunesse », nous confiait Luc Barret peu avant le début cette nouvelle édition.
Le village associatif peine à capter l’attention
Dans l’espace réservé aux associations, l’affluence reste limitée. Malgré la présence de dizaines de stands, de brochures, de préservatifs gratuits ou de dépistages anonymes, les visiteurs s’arrêtent peu. « Les gens viennent pour les concerts. On les comprend, mais c’est frustrant », glisse Bérangère, infirmière bénévole pour AIDES.
À quelques mètres de là, Karim, coordinateur pour le Sidaction, fait le même constat. « Le VIH qu’on appelle Sida n’est plus perçu comme une urgence. Pourtant, une personne sur six ignore encore sa séropositivité. » La prévention continue de s’adresser à un public fragile, mais la concurrence artistique du festival réduit l’impact de ces messages.
« On ne cherche pas à faire peur. Juste à rappeler que le dépistage, est un réflexe vital »
Le relâchement de la vigilance face au Sida inquiète les professionnels de santé. « On parle moins du virus, mais il continue de se transmettre, notamment chez les jeunes », prévient une responsable d’Act Up présente sur le site. À 18 ou 20 ans, beaucoup pensent que la maladie est “réglée”, ou concernait “une autre époque”.
Cette forme d’amnésie générationnelle est au cœur des préoccupations du festival. Pour les équipes de prévention, l’objectif n’est pas de moraliser mais de recréer un espace d’échange. « On ne cherche pas à faire peur. Juste à rappeler que le dépistage, le traitement, le consentement sont des réflexes vitaux », insiste un intervenant de Sol en Si.
Un festival de plus en plus marqué par la logique de marque
Le paysage du festival change aussi sous l’effet de la multiplication des sponsors. Garnier, Mustela, ou encore des marques de boissons ou d’équipement proposent des animations, des tests de peau, des concours ou des cadeaux. L’approche séduit, mais soulève des critiques.
« J’ai parfois l’impression d’être dans un centre commercial en plein air », ironise Maël, 19 ans. Pour les organisateurs, ces partenaires sont indispensables. « Les artistes ne sont plus rémunérés grâce aux CD donc les prix des cachets augmentent, les subventions sont de plus en plus compliquées à avoir et à maintenir. Sans ces soutiens, on ne pourrait pas continuer », explique le fondateur des Solidays.
Le paradoxe est assumé : les marques permettent au festival de survivre, mais elles occupent de plus en plus de place sur le site. L’espace laissé aux messages militants se réduit mécaniquement.
L’esprit militant subsiste, mais il se dilue
Malgré tout, certains festivaliers restent attachés à la cause. Léo, 35 ans, revient chaque année : « Je viens pour la musique, mais aussi pour ce que ça représente. Mon oncle est mort du sida. Ici, je me sens connecté à cette histoire. » Dans les concerts, quelques artistes glissent des mots en faveur des associations, des hommages sont rendus, des vidéos rappellent les missions du festival.
Mais ces rappels sont souvent furtifs. Le public les entend, parfois les applaudit, puis retourne à la fête. L’adhésion est réelle, mais moins structurée qu’à l’origine. Les générations changent, les codes aussi.