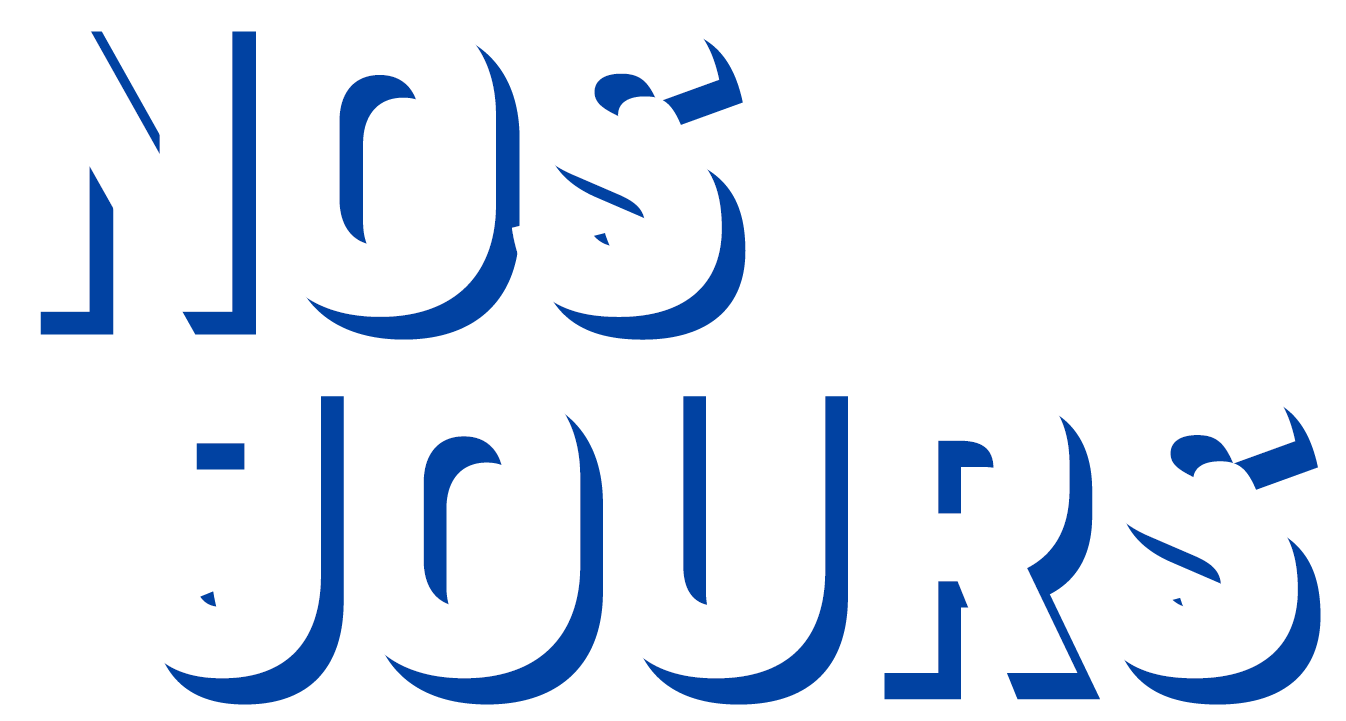Le Congrès américain n’a plus que quelques heures pour trouver un compromis. Faute d’accord budgétaire avant minuit, l’État fédéral sera placé en shutdown, c’est-à-dire en paralysie partielle. Ce mécanisme, propre au système politique américain, intervient lorsque les élus échouent à voter les crédits nécessaires au fonctionnement des administrations. Concrètement, l’État ne peut plus financer ses activités dites « non essentielles » : des centaines de milliers de fonctionnaires sont alors mis en congé forcé, les musées et parcs nationaux ferment, et de nombreux services au public s’interrompent.
Une impasse politique
L’enjeu dépasse la simple technique budgétaire. À Washington, la bataille oppose une Maison-Blanche décidée à tailler dans les dépenses publiques et une opposition démocrate qui refuse de cautionner les coupes annoncées dans l’assurance maladie et certaines aides sociales. Les républicains disposent certes de la majorité dans les deux chambres, mais ils doivent convaincre plusieurs élus démocrates au Sénat pour atteindre le seuil des 60 voix requis. Les discussions, menées en présence de Donald Trump et de son vice-président JD Vance, n’ont pas permis de débloquer la situation.
La stratégie présidentielle est claire : transformer la menace d’un shutdown en levier politique. « S’il faut fermer, il faudra fermer », a lancé Donald Trump. Le président laisse planer l’idée d’utiliser cette crise pour réduire durablement les effectifs fédéraux, accusés de freiner ses réformes. Les démocrates, eux, entendent se poser en défenseurs des classes moyennes, en faisant du financement de la santé leur ligne rouge.
Des conséquences économiques immédiates
Les effets d’un shutdown se font sentir dès les premières heures. Les fonctionnaires jugés essentiels — contrôleurs aériens, forces de l’ordre, militaires — doivent continuer à travailler mais sans être payés immédiatement. Les autres, considérés comme non essentiels, restent chez eux dans l’attente d’un accord. Les précédents shutdowns ont montré l’impact concret sur la vie quotidienne : ralentissement dans les aéroports, aides sociales retardées, arrêt des statistiques économiques produites par les agences fédérales.
L’économie, elle, encaisse rapidement le choc. Chaque semaine de paralysie entraîne une perte de 0,1 % à 0,3 % du PIB trimestriel, selon les estimations d’économistes américains. Le shutdown de 2018-2019, le plus long de l’histoire récente avec 35 jours, avait coûté près de 3 milliards de dollars. Cette fois, les analystes redoutent un impact plus marqué, car l’économie américaine est déjà fragilisée par l’inflation, le ralentissement de la croissance et les tensions commerciales.
À LIRE AUSSI : Une semaine de tous les dangers à Matignon
Les marchés financiers ont commencé à réagir : le dollar s’affaiblit, l’or joue son rôle de valeur refuge et Wall Street redoute un report de la publication de données clés, comme le rapport mensuel sur l’emploi.
Un bras de fer aux répercussions politiques
Depuis 1976, les États-Unis ont connu 22 shutdowns. Si leur coût économique reste limité dans le temps, leurs effets politiques sont durables. En 1995, les républicains avaient payé cher leur intransigeance face à Bill Clinton. En 2019, Donald Trump avait lui-même été affaibli par un blocage lié au financement de son mur frontalier.
Cette fois, la paralysie menace dès le début de son second mandat. Pour Trump, l’épreuve représente un test de leadership et une opportunité de galvaniser son électorat le plus radical. Pour les démocrates, c’est un moyen de montrer qu’ils peuvent encore peser face à un président offensif et à un Congrès dominé par ses partisans.
À un an des élections de mi-mandat, l’issue de ce bras de fer sera scrutée de près par l’opinion. Car au-delà des chiffres et des équilibres budgétaires, c’est la capacité des États-Unis à se gouverner eux-mêmes qui est, une fois encore, mise en cause.