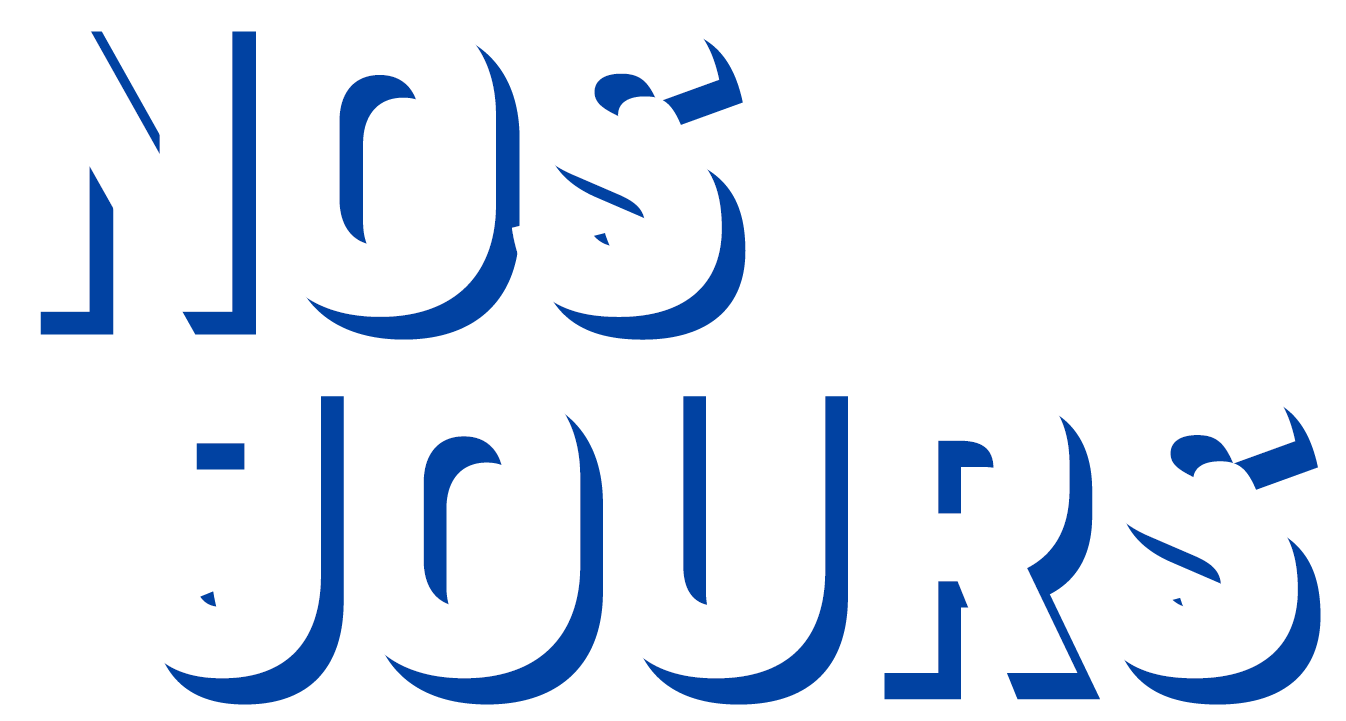On savait Paul Thomas Anderson capable de tordre le cinéma hollywoodien pour en tirer des visions à la fois intimes et grandioses. De Boogie Nights à Magnolia, en passant par There Will Be Blood, il a bâti une œuvre ambitieuse, exigeante, toujours à la frontière du spectaculaire et de l’intime. Avec Une bataille après l’autre, il franchit un cap supplémentaire. Le film, d’une durée de deux heures quarante-deux, se présente à la fois comme une fresque politique, un drame familial et une farce hallucinée, porté par Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro et la révélation Teyana Taylor.
Inspiré du roman Vineland de Thomas Pynchon, transposé dans une Amérique dystopique rongée par le fascisme, le récit confronte les désillusions de la contre-culture aux dérives autoritaires d’un pouvoir militarisé. Au cœur de l’intrigue, la guérillera caribéenne Perfidia (Teyana Taylor) s’éprend du colonel Lockjaw (Sean Penn), incarnation brutale et grotesque de la violence politique. De cette union naît une enfant, Willa, confiée seize ans plus tard à Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), figure paternelle en déroute. Dans ce canevas, Anderson orchestre l’affrontement de forces contradictoires, entre pulsions révolutionnaires et fantasmes autoritaires.
Un opéra cinématographique aux registres multiples
Le film épouse une structure musicale. Chaque séquence semble écrite comme un air, avec sa tonalité propre : drame intime, satire politique, éclats burlesques. Anderson n’hésite pas à bousculer les genres, convoquant tantôt le lyrisme mélodramatique, tantôt le cartoon débridé. Une course-poursuite digne de Bip Bip et Coyote surgit ainsi au milieu de la fresque, assumant le mélange des registres. L’audace pourrait paraître excessive, elle se révèle magistrale, tant la mise en scène maîtrise les passages incessants entre tragédie et comédie.
À LIRE AUSSI : https://nosjours.fr/culture/la-collision-de-paul-gasnier/
Ce foisonnement ne masque pas la dimension politique. En filmant l’ascension de figures autoritaires, Anderson convoque les spectres de Reagan et de Trump, mais refuse le didactisme. « Les métaphores ne sont jamais bonnes pour le cinéma », rappelle-t-il. Le colonel Lockjaw n’est pas un symbole mais un personnage de chair et de fureur, que Sean Penn rend tour à tour grotesque et inquiétant. Ce refus de la simplification confère au film une puissance singulière : il dit l’Amérique contemporaine sans la réduire à une parabole.
Un film-monstre pour notre époque
Rarement Hollywood aura semblé aussi libre. Là où l’industrie multiplie les superproductions interchangeables, Une bataille après l’autre revendique la densité, la complexité et la démesure. Le film fascine autant qu’il déroute, embrassant les contradictions d’un début de millénaire fiévreux. C’est un film-monstre, un spectacle total qui refuse la facilité et assume ses excès.
Anderson signe une déclaration d’amour paradoxale au cinéma américain. Son œuvre a les dimensions d’un blockbuster, mais la rigueur d’un film d’auteur. Elle prouve qu’il est encore possible de produire un spectacle adulte, exigeant, qui interroge le présent sans sacrifier la mise en scène. On pourra lui reprocher sa longueur ou son foisonnement, mais Une bataille après l’autre restera comme un jalon majeur : la preuve qu’un auteur peut encore croire au pouvoir du cinéma, et l’imposer à Hollywood.