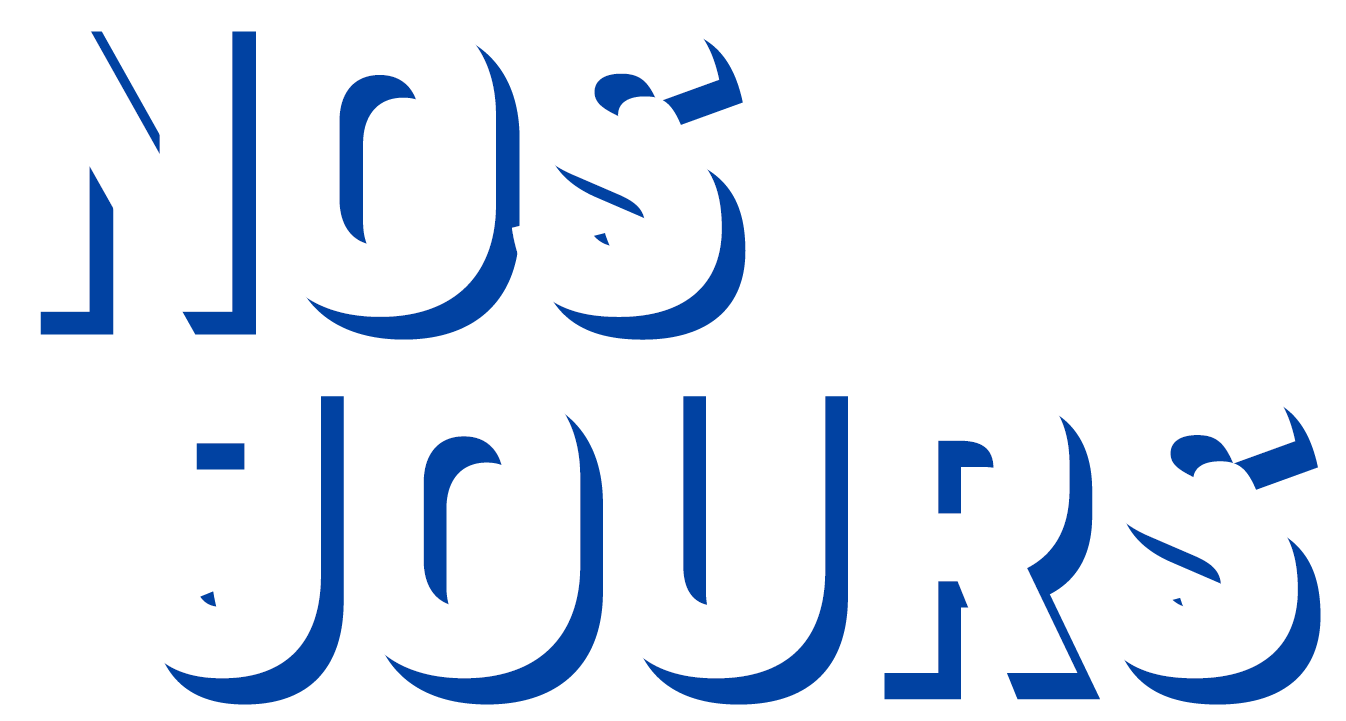La taxe Zucman, sur le papier, la proposition est séduisante : imposer un minimum de 2 % sur le patrimoine des ménages ultra-riches, à partir de 100 millions d’euros. Inspirée par l’économiste Gabriel Zucman, adoptée par l’Assemblée nationale mais rejetée par le Sénat, elle viserait environ 1 800 foyers fiscaux. Selon ses promoteurs, l’État pourrait en tirer jusqu’à 25 milliards d’euros par an.
Mais la logique apparente de justice fiscale se heurte à une réalité plus complexe. La taxe ne se calcule pas sur le revenu mais sur la valorisation du capital, une donnée mouvante et souvent éloignée des liquidités réellement disponibles.
Une confusion entre patrimoine et argent disponible
Le mécanisme repose sur une évaluation du patrimoine net : actifs immobiliers, participations financières, entreprises non cotées, parfois œuvres d’art. Or, la valorisation n’équivaut pas à de l’argent disponible. Un entrepreneur peut détenir 200 millions d’euros en parts de sa société sans pour autant pouvoir sortir 4 millions de liquidités par an pour payer l’impôt.
« C’est comme demander à quelqu’un qui possède un château de régler ses impôts en vendant une aile », résume un fiscaliste interrogé par Les Échos. L’enjeu est d’autant plus fort que ces patrimoines sont souvent illiquides : le capital détenu n’est pas de la trésorerie immédiatement mobilisable.
Le risque d’obliger à vendre
Face à cette contrainte, les contribuables concernés n’auraient guère d’alternative que de vendre une partie de leurs actifs. Or, sur des sociétés familiales ou des entreprises stratégiques, cela reviendrait à ouvrir le capital à des investisseurs extérieurs. « On risque de provoquer une mise en vente forcée des joyaux français au bénéfice de capitaux étrangers », avertit un ancien membre de Bercy.
Cette critique rappelle les débats autour de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune, accusé d’avoir poussé des familles à céder leurs entreprises. « La taxe Zucman, c’est la promesse de renforcer le capitalisme d’État… chinois ou américain », ironise un député du centre droit.
Une usine à gaz administrative
Au-delà du principe, l’application soulève un casse-tête technique. Comment valoriser équitablement une participation dans une société non cotée, ou un actif atypique ? Le Conseil des prélèvements obligatoires a souligné le risque de contentieux multiples. Même l’estimation de l’impôt déjà payé par ces contribuables est complexe, tant les prélèvements sont éclatés entre revenus, plus-values, cotisations sociales et fiscalité immobilière.
Un haut fonctionnaire résume : « L’administration fiscale n’est pas équipée pour calculer un impôt basé sur des valorisations mouvantes et contestables. » Résultat : une mesure présentée comme simple pourrait devenir l’une des plus lourdes et coûteuses à administrer.
Une popularité politique mais des effets incertains
L’idée reste populaire : selon un sondage cité par RTL, 75 % des Français y sont favorables. Pour le Premier ministre Olivier Faure, la taxe incarne « un signal de justice et de responsabilité ». Mais à mesure que les détails techniques se précisent, les réserves s’accumulent.
À LIRE AUSSI : Pourquoi les pick-up Toyota sont devenus des armes de guerre
Entre confusion sur la notion de capital, risque de ventes forcées à l’étranger et usine à gaz administrative, la taxe Zucman apparaît moins comme une réforme pragmatique que comme un étendard idéologique. Comme le dit un proche du nouveau premier ministre critique : « Le problème n’est pas d’aller chercher l’argent là où il est, mais de comprendre qu’il n’y est pas forcément sous forme d’argent. »