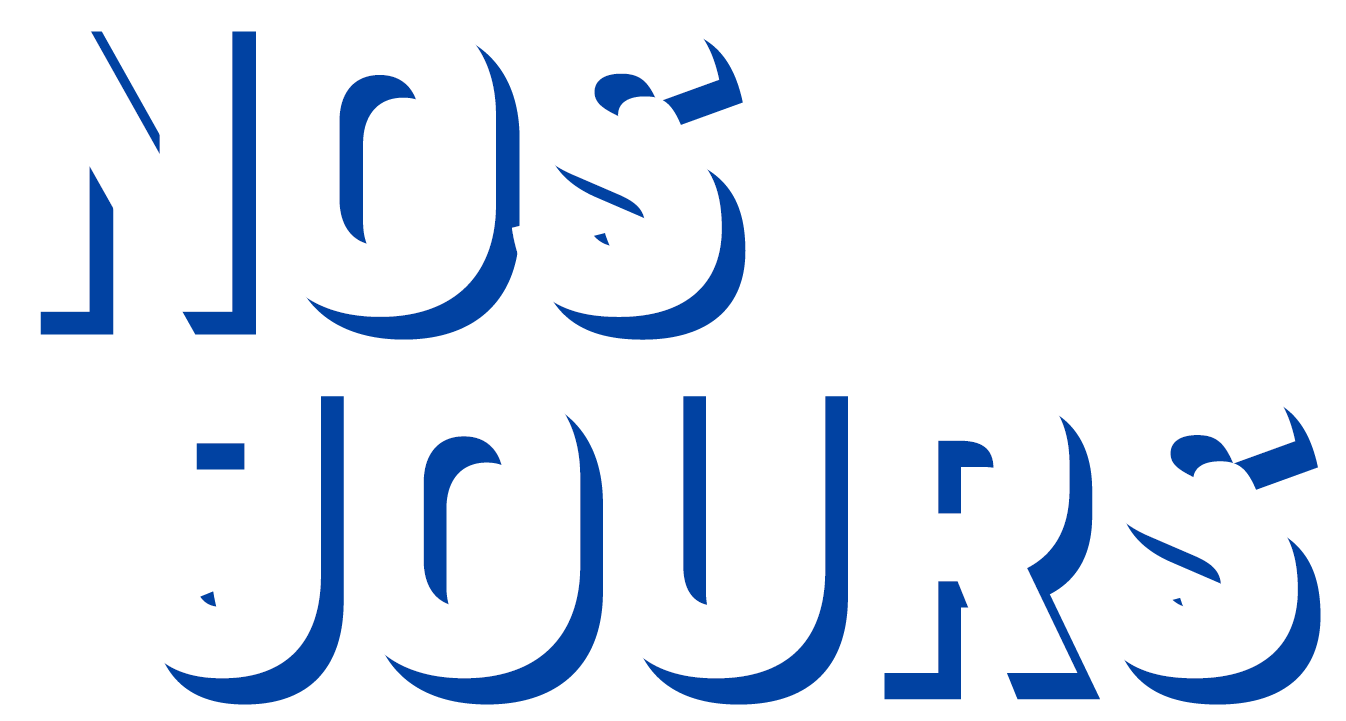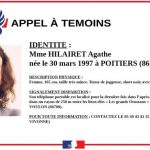MONTREAL, 11 avril 2025– Le Canada pourrait bien devenir l’un des territoires les plus convoités dans la guerre mondiale pour la suprématie en intelligence artificielle. Mais à quel prix pour sa souveraineté énergétique et environnementale ?
C’est l’un des messages lancés par Eric Schmidt, ancien PDG de Google, ce vendredi à la conférence TED de Vancouver : « Pensez Canada », a-t-il glissé, en vantant les ressources hydroélectriques canadiennes comme solution clé au goulet énergétique que traverse l’industrie de l’IA aux États-Unis.
Avec la multiplication des modèles d’intelligence artificielle générative, les besoins explosent : « Le secteur va avoir besoin de 90 gigawatts de plus aux États-Unis. L’équivalent de 90 centrales nucléaires. Et cela n’arrivera pas », a prévenu Schmidt. « Mais au nord, il y a de l’électricité, et des gens très gentils. »
Des milliards de dollars… et peu de retombées locales ?
Le Canada, et particulièrement le Québec et la Colombie-Britannique, attire déjà les data centers grâce à son énergie propre, son climat froid et sa stabilité politique. Plus de 250 centres sont installés sur le territoire, et d’autres projets sont en cours, portés notamment par Amazon Web Services, Google Cloud ou Microsoft Azure.
Ottawa se montre favorable. En décembre dernier, le gouvernement fédéral a proposé un plan d’incitations à hauteur de 15 milliards de dollars pour soutenir la création de centres de données verts. De son côté, le chef conservateur Pierre Poilievre, favori dans les sondages, appelait dès janvier à « libérer » la production d’énergie pour « ramener l’argent à la maison ».
Mais ces implantations massives interrogent. Car si les entreprises de la tech bénéficient d’un accès à bas prix à une électricité verte produite en majorité par des entreprises publiques comme Hydro-Québec, les retombées économiques directes restent limitées. Peu d’emplois créés, peu d’impôts collectés, des sols artificialisés, et une pression croissante sur le réseau.
La tentation d’un modèle extractif
« On est en train de transformer notre électricité verte en matière première brute exportée sans valeur ajoutée », dénonce un haut fonctionnaire québécois sous couvert d’anonymat. « On ne développe pas un écosystème technologique local, on alimente les ambitions des GAFAM. »
Le parallèle avec les industries extractives historiques – mines, forêts, hydrocarbures – est dans toutes les têtes. « Le Canada risque de répéter un vieux schéma : fournir les ressources, laisser les bénéfices ailleurs », analyse l’économiste Bruno Lévesque, auteur d’un rapport sur les infrastructures numériques publié à l’Université Laval.
Un risque environnemental sous-estimé
En arrière-plan, la question environnementale. Car l’hydroélectricité n’est pas infinie. Au Québec, plusieurs barrages tournent déjà à pleine capacité, et la sécheresse qui a frappé le pays ces dernières années a mis à mal la production. En Colombie-Britannique, des projets de nouveaux barrages soulèvent de vives oppositions, notamment chez les communautés autochtones.
« Ce qui est présenté comme une énergie propre peut devenir un nouveau front de conflits environnementaux et sociaux », alerte l’activiste Éloïse Roy, du collectif Énergie Citoyenne. « On parle de construire pour les data centers, mais pas pour la transition énergétique des Canadiens. »
Une souveraineté numérique à construire
Si le Canada veut tirer profit de son avantage énergétique, certains experts plaident pour une approche plus stratégique. Favoriser les projets porteurs de retombées locales, imposer des normes de rentabilité énergétique, miser sur l’innovation publique.
« Nous avons une carte à jouer », estime le chercheur Jean-Noël Beaudry, spécialiste des politiques numériques à Polytechnique Montréal. « Mais à condition de ne pas devenir la batterie bon marché de l’empire numérique américain. »