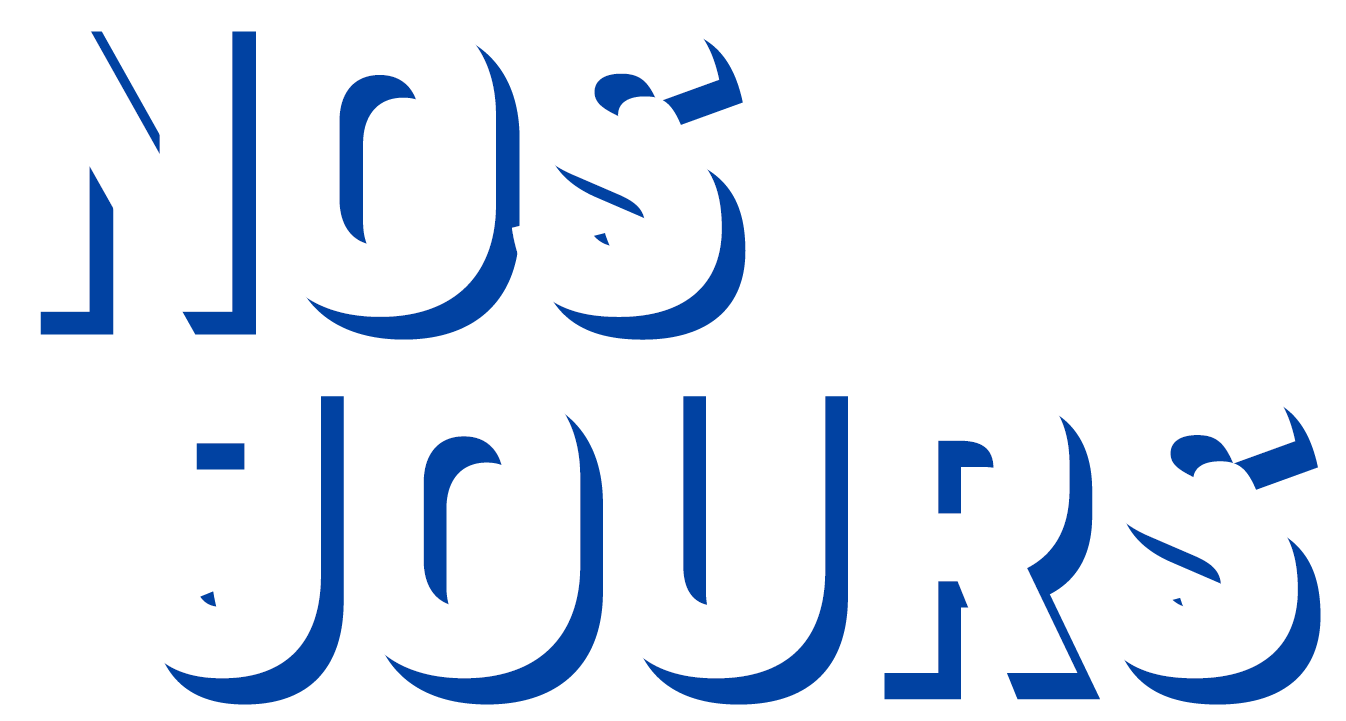C’est un discours qui restera comme l’un des plus inattendus du mandat Trump. Mardi, à la tribune des Nations unies, le président américain a affirmé que l’Ukraine pouvait « regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin » face à la Russie. Un propos en totale rupture avec la ligne suivie depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, lorsqu’il multipliait les gestes d’ouverture envers Vladimir Poutine.
En l’espace de quelques phrases, Donald Trump a redonné espoir à Kiev et à ses soutiens européens, tout en provoquant une riposte cinglante de Moscou. Reste à savoir si cette inflexion n’est qu’une posture conjoncturelle ou le signe d’un changement durable dans l’approche américaine du conflit.
À Berlin, l’espoir d’une pression accrue sur Moscou
Le premier à réagir fut Berlin. « Les déclarations de Donald Trump nous donnent des raisons d’espérer que nous pourrons à nouveau discuter intensivement de ce sujet et maintenir la pression sur la Russie », a déclaré mercredi Stefan Kornelius, porte-parole du gouvernement allemand. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a néanmoins nuancé en appelant à la retenue : « Le risque serait de tomber dans le piège de l’escalade. »
Cette prudence illustre les dilemmes européens. Après deux ans et demi de guerre, les capitales de l’UE peinent à trouver un équilibre entre fermeté et peur de l’engrenage. En affichant un soutien verbal sans préciser les moyens militaires ou financiers, Donald Trump semble avoir ouvert une fenêtre, mais sans en dessiner les contours.
Moscou monte au créneau
À Moscou, la réaction fut immédiate. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a dénoncé une « thèse erronée », avant de railler la comparaison de Trump selon laquelle la Russie serait un « tigre de papier ». « La Russie est davantage associée à un ours. Et les ours de papier n’existent pas », a-t-il ironisé, défendant la « stabilité économique » du pays malgré les sanctions.
Le discours du président américain n’a pas empêché l’armée ukrainienne de poursuivre ses attaques. Dans la nuit de mardi à mercredi, des drones ont frappé une raffinerie du Bachkortostan, provoquant un violent incendie, et tué deux personnes à Novorossiïsk, près de la mer Noire. Ces offensives soulignent que, malgré la rhétorique américaine, le rapport de forces sur le terrain reste incertain.
L’Alliance atlantique fragilisée par ses divisions
Plus que le fond, c’est le ton employé par Donald Trump qui interroge. Le président a encouragé les pays de l’Otan à « abattre les avions russes » violant leur espace aérien, alors même que des incidents se multiplient en Pologne, en Estonie ou en Roumanie. Cette ligne dure a été immédiatement saluée par Varsovie et les pays baltes, mais critiquée par Berlin et Helsinki, soucieux d’éviter une confrontation directe.
La cacophonie a révélé au grand jour les fractures au sein de l’Alliance. Washington lui-même apparaît divisé : quand Trump se dit favorable à une riposte militaire, son secrétaire d’État Marco Rubio rappelle que la doctrine de l’Otan consiste à intercepter les appareils intrus, non à les détruire. Cette ambiguïté pourrait, à terme, fragiliser la crédibilité de l’organisation.
Les marchés financiers à l’affût
La volte-face présidentielle a aussi trouvé un écho immédiat sur les marchés. Les valeurs de la défense se sont envolées : Rheinmetall à Francfort, BAE Systems à Londres, Saab à Stockholm, Dassault à Paris. En Asie, Hanwha Aerospace en Corée du Sud et Mitsubishi Heavy Industries au Japon ont bondi, profitant des anticipations d’une hausse des budgets militaires.
Les matières premières n’ont pas été épargnées. Le pétrole a progressé au-delà de 68 dollars le baril de Brent, porté par la crainte de sanctions supplémentaires contre Moscou et par les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. Le métal jaune, valeur refuge par excellence, a atteint un nouveau sommet, au-delà de 3.750 dollars l’once.
Même les devises régionales ont vacillé : le zloty polonais a reculé face à l’euro, signe de l’inquiétude des investisseurs quant au risque d’incidents aériens.
Renault, symbole des dilemmes industriels français
Au-delà des marchés, c’est aussi l’industrie européenne qui se retrouve en première ligne. Renault a confirmé mercredi avoir été sollicité par la Direction générale de l’armement pour participer à la production de drones en Ukraine. Le constructeur automobile, qui tente de se réinventer après des années difficiles, a adressé une note interne à ses salariés pour « répondre à leurs questions légitimes ».
Le groupe assure qu’il ne deviendra pas un « acteur majeur de la défense » et qu’il ne s’engagera que si le projet « a un impact positif sur l’activité » en France. Mais l’idée même d’impliquer les chaînes automobiles dans l’armement illustre la pression croissante qui pèse sur les industriels européens.
Un revirement encore à confirmer
En changeant brutalement de discours, Donald Trump a relancé le débat sur le rôle des États-Unis dans une guerre qui dure depuis plus de trois ans. Mais il n’a rien dit des moyens concrets que Washington serait prêt à engager : maintien des sanctions, aide militaire, médiation éventuelle. « Bonne chance à tout le monde », a-t-il même lancé, laissant planer l’ambiguïté.
Ce mélange de fermeté verbale et d’imprécision stratégique alimente le scepticisme à Kiev. « Attendons une semaine de plus, il pourrait dire autre chose », soupire Artiom, 24 ans, rencontré par l’AFP dans la capitale. Un constat amer qui résume l’incertitude dans laquelle se trouvent les alliés européens : Trump a rebattu les cartes, mais personne ne sait encore s’il a vraiment changé de jeu.